
64.8K
Downloads
225
Episodes
Maghrib in Past & Present | Podcasts is a forum in which artists, writers, and scholars from North Africa, the United States, and beyond can present their ongoing and innovative research on and in the Maghrib. The podcasts are based on lectures, live performances, book talks, and interviews across the region. Aiming to project the scientific and cultural dynamism of research in and on North Africa into the classroom, we too hope to reach a wider audience across the globe.
Maghrib in Past & Present | Podcasts is a forum in which artists, writers, and scholars from North Africa, the United States, and beyond can present their ongoing and innovative research on and in the Maghrib. The podcasts are based on lectures, live performances, book talks, and interviews across the region. Aiming to project the scientific and cultural dynamism of research in and on North Africa into the classroom, we too hope to reach a wider audience across the globe.
Episodes

Monday Jun 03, 2019
Tuning in to Morocco’s “Recitational Revival”
Monday Jun 03, 2019
Monday Jun 03, 2019
Episode 66: Tuning in to Morocco’s “Recitational Revival”
According to some religious leaders and other intellectuals, Morocco is in the midst of a 'recitational revival' (sahwa tajwidiyya). Though its scope and effectiveness are not yet clear, the intention is a re-emphasis on two core Islamic disciplines that relate to recitation of the Qur’an: first, tajwid, a system of rules that govern pronunciation and rhythm of the Qur’anic text in recitation performance; and the variance of those rules across seven, coherent, recitals or 'readings' (qira’at) that are equally sound. Within this revival, Moroccan’s historical preference for riwayat warsh, a lesser-practiced variant of one of the seven qira’at has become almost a point of national pride, and thus the Moroccan state has devoted many resources not only to specialist study of the qira’at, but also popularization of tajwid through mass media.
Engaging fieldwork at a variety of institutions, including new and pre-existing schools and state radio, in this Podcast, Ian VanderMeulen, doctoral candidate in Middle Eastern and Islamic Studies at New York University, maps an institutional framework of this revival and describes some of its core elements. In particular, he compares and contrasts the work going on at two institutions of qira’at study, the state-funded Ma‘had Muhammad Assadiss lil-dirasat wal-qira’at al-Qur’aniyya in Rabat, and the private Madrasat Ibn al-Qadi lil-qira’at in Sale. Taking inspiration from the growing field of 'sound studies,' and grounding his fieldwork in historical research on tajwid, the qira’at, and the history of sound recording, Ian suggests that the sahwa tajwidiiyya is less a 'revival' of previous practices of recitation per se, but a refashioning of such practices and their pedagogies through the application of new technologies, from modern classroom whiteboards to digital studio recording.
A performing musician, Ian holds bachelor’s degrees in music and religious studies from Oberlin College and an M.A. from The Graduate Center, City University of New York. His research in France and Morocco has been funded by NYU’s Graduate Research Initiative and the American Institute for Maghrib Studies.
This podcast was recorded at the Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies (TALIM) on February 7, 2019.
Posted by Hayet Lansari, Librarian, Outreach Coordinator, Content Curator (CEMA).

Thursday May 30, 2019
l'Oasis de Jemna en Tunisie, entre dissidence et négociation
Thursday May 30, 2019
Thursday May 30, 2019
Episode 65: l'Oasis de Jemna en Tunisie, entre dissidence et négociation
Dans ce Podcast, Pr. Mohammed Kerrou, professeur de sciences politiques à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, Université de Tunis El-Manar et Professeur visiteur dans plusieurs universités étrangères (Aix-en-Provence, Tarragone, Rome La Sapienza, Yale University...) présente une de ses enquêtes sur l'Oasis de Jemna. Située au Sud-Ouest tunisien, cette oasis est devenue dans le sillage de « la révolution de la dignité », le lieu d’exercice d’une citoyenneté libre et conviviale, par le biais de la récupération d’un ancien domaine agricole colonial « Henchir el-mâamer ») devenu, au lendemain de l’indépendance nationale, domaine de l’Etat. Du coup, le conflit entre la légalité étatique et la légitimité de l’appropriation de la terre par les Oasiens offre l’opportunité d’un débat démocratique inédit. L’Association de protection des Oasis de Jemna, expression de la société civile locale, se trouve aujourd’hui en rapport de négociation avec les autorités en vue de la création d’une coopérative de production agricole. L’enjeu consiste dans la résistance en vue de réaliser l’objectif d’une économie sociale et solidaire, tout en maintenant la flamme de cette expérience innovante. Toutefois, une telle expérience court le risque, à l’instar de tous les mouvements de mobilisation collective, de l’étiolement progressif et de la banalisation par le système de reproduction inégalitaire, tant sur le plan social que régional, réduisant de la sorte l’expérience à un produit historique des marges, avec ce que cela implique comme processus de marginalisation et d’isolement des individus et des communautés périphériques.
Pr Mohamed Kerrou est l'auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels :
- Tunisie, l’autre révolution. Essai, Tunis, Editions Cérès, 2018.
- L’homme des questions. Hommage à Abdelkader Zghal (1930-2015), Tunis, Cérès Editions, 2016.
- Hijâb. Nouveaux voiles et espaces publics, Tunis, Editions Cérès, 2010.
- Kairouan. Phare éternel de l’islam, Tunis, Editions Apollonia, 2009.
- D’Islam et d’Ailleurs. Hommage à Clifford Geertz (1926-2006), Tunis, Cérès Editions, 2007.
- Public et Privé en Islam. Espaces, autorités et libertés, Paris, Maisonneuve & Larose, 2002.
- L'Autorité des Saints. Perspectives historiques et anthropologiques en Méditerranée Occidentale. Postface de Lucette Valensi, Paris, ERC, 1998.
La conférence de Pr. Mohammed Kerrou a été programmée dans le cadre du cycle des conférences « Espaces et territoires au Maghreb » co-organisé par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA) et le Centre de Recherche en Anthropologie sociale et culturelle (CRASC) . Elle a eu lieu le 24 avril 2019 au CRASC. Pr. Abdelkrim Elaidi, sociologue à l'Université d’Oran 2 a modéré le débat.
Pour consulter les cartes associées à ce Podcast, veuillez visiter notre site web: www.themaghribpodcast.com
Nous remercions Dr. Tamara Turner, Ethnomusicologue et chercheure à Max Planck Institute for Human Development, Center for the History of Emotions pour son interprétation de Sidna Boulal du répertoire Hausa du Diwan (Hausa Sug).
Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday May 15, 2019
Wednesday May 15, 2019
Episode 64: صناعة البحر المتوسط في المتخيلة الاسلامية، تصور المسلمين لمنطقة البحر المتوسط من خلال تاريخ الخرائط من القرن العاشر للقرن السادس عشر
(In Arabic)
In this podcast, Dr. Tarek Kahlaoui presents his recent book, Creating the Mediterranean: Maps and the Islamic Imagination (Brill, 2017), in which he traces the depictions of the Mediterranean from from Islamic sources dating between the 9th to the 16th century. During that span, he argues, the profession of map-makers shifted from bureaucratic authors to active mariners and professional cartographers, whereas the, from the dominance of the centers of the Islamic dominion in the eastern Islamic lands to the Maghrib.
Dr. Kahlaoui (Ph.D University of Pennsylvania, 2008) is currently an assistant professor at the South Mediterranean University (Tunisia). He was formerly an assistant professor at Rutgers University and the general director of the Tunisian Institute of Strategic Studies. His research focuses on Mediterranean history and visual culture.
This episode is part of the History of the Maghrib / History in the Maghrib series organized by the Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA) and was recorded on 28 April 2019 at Unité de Recherche sur la Culture, Communication, Langues, Littérature et Arts (UCCLLA).
Ms. Saliha Snouci, Researcher (CRASC), moderated the discussion.
To see related slides visit our web page www.themaghribpodcast.com
We thank our friend Ignacio Villalón, Master candidate at EHESS, for his guitar performance for the introduction and conclusion of this podcast.
Realization and editing: Hayet Lansari, Librarian, Outreach Coordinator, Content Curator (CEMA).

Wednesday Apr 24, 2019
Wednesday Apr 24, 2019
Episode 63: Entretien avec Dr. Khadija Mohsen-Finan sur son dernier livre : Les Dissidents du Maghreb depuis les Independences
Dans ce podcast, Dr. Meriem Guetat , Directrice Adjointe du CEMAT, s’entretient avec Dr. Khadija Mohsen-Finan sur son dernier livre Les Dissidents du Maghreb depuis les Indépendences.
L’ouvrage de Dr. Khadija Mohsen-Finan est l’un des premiers travaux post-2011 qui s’intéressent au concept de la dissidence à travers le Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) et qui se base sur une recherche rétrospective de longue durée.
Dans cet episode, Dr. Mohsen-Finan souligne l’importance d’étudier l’histoire du Maghreb à travers le prisme de la dissidence, tout courants idéologiques confondus, ce qui constitue un renversement de la perspective traditionnelle de recherche se concentrant exclusivement sur le pouvoir. Selon Dr. Mohsen-Finan, il s’agit d’aborder une histoire méconnue du Maghreb qui permet de comprendre ses diffrentes évoultions historiques mais aussi d’interprèter et d’imaginer les développements politiques futures dans la région.
Lors de cette conversation, Dr. Mohsen-Finan a été invitée à répondre à un nombre de questions s’articulant autour des thèmes suivant :
- La définition de la notion de dissidence dans son ouvrage ainsi que le rapport du dissident au pouvoir.
- Les moments phares de l’histoire du Maghreb qui décrivent au mieux le rapport de lutte entre le pouvoir et ses opposants et ce en concentrant sur le moment Youssefiste et de l’affaire Ahmed Ben Salah.
- Le groupe « perspectives » en Tunisie et l’évolution de ses relations avec le pouvoir.
- Le rôle des défenseurs des droits humains et le rôle joué par la LTDH dans l’analyse de la Tunisie.
- Le printemps noir de Kabylie dans le cadre de la dissidence post-2011 et le rôle des minorités ethniques et linguistiques pour la compréhension de la notion de dissidence.
Dr. Khadija Mohsen-Finan est politologue spécialiste du Maghreb et du monde arabe, Docteur en sciences politiques (IEP Paris) et diplômée d’histoire (Université d’Aix-en-Provence). Actuellement enseignante et chercheure à l’Université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne (laboratoire SIRICE), elle enseigne parallèlement à l’Université Ca’Foscari de Venise. Elle contribue également au comité de rédaction et à l’animation du journal en ligne Orient XXI.
Cet épisode a été enregistré le 21 février 2019 au Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT) et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences Pensées contemporaines.
Nous remercions notre ami Mohammed Boukhoudmi pour son interpretation de l'extrait de nouba, "Dziriya," par Dr. Noureddine Saoudi pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.
Posted by Hayet Lansari, Librarian, Outreach Coordinator, Content Curator (CEMA).

Wednesday Apr 03, 2019
Le trauma colonial: enquête sur les effets de l’oppression coloniale en Algérie
Wednesday Apr 03, 2019
Wednesday Apr 03, 2019
Episode 62: Le trauma colonial: enquête sur les effets de l’oppression coloniale en Algérie
Dans ce podcast, Karima Lazali, psychologue clinicienne / psychanalyste, présente son livre, Le trauma colonial: enquête sur les effets de l’oppression coloniale en Algérie (Éditions Koukou, 2018).
L’absence de travaux sur les effets psychiques de la colonisation en France et en Algérie, depuis Frantz Fanon, nous interpelle. Les effets du colonial relèvent-ils pour les deux sociétés d’une forme d’impensé à l’œuvre ? Malgré une forte présence dans les discours en Algérie de cet épisode de l’histoire, il n’empêche, que le recensement précis des problématiques dans les subjectivités et le social est resté lettre en souffrance.
A partir de sa pratique de la psychanalyse dans les deux sociétés et du constat freudien d’une étroite intrication entre l’individuel et le collectif, Karima Lazali va tenter d’entrer dans cet univers des mémoires ou l’archivage habituel fonctionne difficilement pour construire des récits pluriels et singuliers. La confiscation politique de l’histoire dans les deux sociétés mène à l’hypothèse que nous avons affaire à un pacte dans lequel l’effacement joue un rôle majeur pour fabriquer une mémoire brouillée.
Dans ce podcast, Lazali aborde donc quelques questions fondamentales :
- Le rapport à la parole, aux peurs et aux censures dans la société contemporaine algérienne.
- Comment les subjectivités et la structure du politique ont été façonnés par un tissage politique qui porte et reconduit le système colonial.
- La fabrique de l’illégitimité individuelle et politique comme conséquences majeures de la colonisation
- L’apport de la littérature algérienne pour traiter et soigner des déchirures du collectif et des subjectivités troublées dans la construction des traces mémorielles.
- Et enfin si pour la psychanalyse il n’y a de trauma qu’individuel alors comment penser les déflagrations intimes d’une histoire collective ? Qu’est-ce que l’héritage à l’échelle du collectif ? Est-ce juste une manière passive de recevoir la destruction sur plusieurs générations ? Ou n’est-ce pas plutôt une façon d’écrire cette destruction quitte parfois à y participer durant de très nombreuses décennies ?
La conférence de Karima Lazali a été programmée dans le cadre du cycle des conférences « Histoire du Maghreb, histoire au Maghreb » organisé par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA). Elle a eu lieu le 06 mars 2019 au CEMA. Pr. Mohamed Mebtoul, sociologue, a modéré le débat.
Nous remercions Dr. Jonathan Glasser, anthropologue culturel au College of William & Mary, pour son istikhbar in sika à l'alto pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.
Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Thursday Mar 21, 2019
Thursday Mar 21, 2019
Episode 61: Power and Ridicule: Political Mockery and Subversion in the Middle East and North Africa
In this podcast, Prof. Charles Tripp discusses how humor and mockery are considered ways of resilience against power through the use of cartoons, songs, images, or any form of art to reveal the lies, hypocrisy of those in power.
Prof. Tripp is Professor Emeritus of Politics with reference to the Middle East and North Africa at the School of Oriental and African Studies, University of London, and is a Fellow of the British Academy. His PhD was from SOAS and examined Egyptian politics in the latter years of monarchy. At SOAS he has been head of the Centre for Middle Eastern Studies and is one of the co-founders of the Centre for Comparative Political Thought. His research has mainly focused on political developments in the Middle East and includes the nature of autocracy, war and the state, as well as Islamic political thought, the politics of resistance and the relationship between art and power. He is currently working on a study of the emergence of the public and the rethinking of republican ideals in North Africa.
This episode is part of the Contemporary Thought series and was recorded on February 14th, 2019 at the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT).
To see related slides, visit our web page www.themaghribpodcast.com
We thank Mr. Souheib Zallazi, (student at CFT, Tunisia) and Mr. Malek Saadani (student at ULT, Tunisia), for their interpretation of el Ardh Ardhi of Sabri Mesbah, performed for the introduction and conclusion of this podcast. Souheib on melodica and Malek on guitar.
Posted by Hayet Lansari, Librarian, Outreach Coordinator, Content Curator (CEMA).

Wednesday Mar 13, 2019
Interview avec Pr. Mohammed Kerrou sur son dernier livre : L’Autre Révolution
Wednesday Mar 13, 2019
Wednesday Mar 13, 2019
Episode 60: Interview avec Pr. Mohammed Kerrou sur son dernier livre : L’Autre Révolution
Dans ce Podcast, Pr. Mohammed Kerrou, professeur de sciences politiques à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, Université de Tunis El-Manar, revient sur son nouvel ouvrage, L'autre révolution (Cérès Éditions, 2018). L'ouvrage est une série de réflexions sur les transformations politiques et sociales en Tunisie depuis la révolution de 2011. Pr. Kerrou examine comment les tendances politiques postrévolutionnaires ont soulevé des questions théoriques autour des termes « rupture » et « continuité ». Il pose des questions sur la nature de l'État et les relations entre l'État et la société ; le rôle de la société civile ; la transformation de l'espace politique ; les mythes de l'origine de la révolution ; la question de la religion et du religieux ; ainsi que l'évolution des notions de citoyenneté dans la Tunisie contemporaine.
Cet épisode est présenté sous forme d'entretien, avec Dr. Laryssa Chomiak, Directrice du Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT). Il a été enregistré le 21 février 2019 au CEMAT et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences Pensées contemporaines.
Nous remercions Emna Ben Issa et Bassem Zribi de l'Institut Supérieur de Musique à Tunis d'avoir bien accepté d'interpréter Bani Watani pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.
Posté par: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday Feb 27, 2019
L’architecture de la contre-révolution : l’armée française dans le nord de l’Algérie
Wednesday Feb 27, 2019
Wednesday Feb 27, 2019
Episode 59: L’architecture de la contre-révolution :
L’armée française dans le nord de l’Algérie
Dans ce Podcast, Dr. Samia Henni, historienne d’architecture au Département d’Architecture à Cornell Université présente son livre, L’Architecture de la contre-révolution : L’Armée française dans le nord de l’Algérie.
Elle examine l'intersection des politiques coloniales françaises et des opérations de contre-insurrection militaires en architecture en Algérie pendant la révolution algérienne (1954-1962). Au cours de ce conflit armé sanglant et prolongé, les autorités civiles et militaires françaises ont profondément réorganisé le vaste territoire urbain et rural de l'Algérie, transformé radicalement son environnement bâti, implanté rapidement de nouvelles infrastructures et construit de nouvelles implantations stratégiques afin de maintenir l'Algérie sous domination française. Le régime colonial avait conçu et mené à bien non seulement des destructions tactiques, mais aussi de nouvelles constructions afin de permettre un contrôle strict de la population algérienne et la protection des communautés européennes algériennes.
Cette étude porte sur trois mesures contre-révolutionnaires spatiales interdépendantes : la réinstallation forcée massive d'agriculteurs algériens ; les programmes de logements de masse conçus pour la population algérienne dans le cadre du Plan de Constantine du général Charles de Gaulle ; et la nouvelle ville administrative fortifiée prévue pour la protection des autorités françaises au cours des derniers mois de la révolution algérienne. L'objectif est de décrire le mode opératoire de ces établissements, leurs racines, leurs développements, leurs champs d'action, leurs acteurs, leurs protocoles, leurs impacts et leurs mécanismes de conception.
La conférence de Dr. Samia Henni a été programmée dans le cadre du cycle des conférences « Espaces et territoires au Maghreb » co-organisé par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA) et le département d’architecture de l'Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf (USTO-MB). Elle a eu lieu le 24 janvier 2019 à la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie (SNV), USTO-MB, Oran. M. Rabia Mouloud Chef du département d’architecture Faculté d’architecture et de génie civil, USTO-MB a modéré le débat.
Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast veuillez visiter notre site web www.themagribpodcast.com .
Nous remercions notre ami Ignacio Villalón pour sa prestation à la guitare pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.
Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday Feb 13, 2019
Moroccan and Ottoman Contributions to 18th c. Diplomatic Developments
Wednesday Feb 13, 2019
Wednesday Feb 13, 2019
Episode 58: Moroccan and Ottoman Contributions to 18th c.
Diplomatic Developments
Throughout the eighteenth century, the Ottoman and Russian Empires were at war. However, a decisive victory by the Russian Empire helped them assert their influence over both Crimea and the Mediterranean. The Ottomans, wanting to counteract this assumption of power fought to prevent Russian ships from entering through the Straits of Gibraltar, seeking assistance from the Moroccan king Sidi Muhammed Ben Abdallah. In this episode, Peter Kitlas, Ph.D. Candidate at the Department of Near Eastern Studies at Princeton University, discusses the vibrant developments in diplomatic activity between Morocco and the Ottoman Empire throughout the eighteenth century. The increased exchange of diplomats between these two non-European powers demonstrates how Morocco and the Ottoman Empire responded to changes in international relations during this time period while still maintaining a particular diplomatic ethos.
Focusing on some entertaining anecdotes about diplomats and their adventures, Peter takes us through the travelogues (riḥla and sefaretname) of several Moroccan and Ottoman diplomats to demonstrate how they navigated the changing field of international relations. Here, Peter highlights that diplomatic history should deal just as much with developments in bureaucracy and statecraft as it does with its foundational standards and practices governed by a particular diplomatic mentality. Focusing on both actions and the governing influences behind those actions will help bring Morocco and the Ottoman Empire into broader conversations about diplomacy during this time period and might even help to uncover outlying developments in the European theater that have not fit into the particular ethos of a state-craft focused, bureaucratic teleology.
Peter Kitlas is a doctoral candidate in the Department of Near Eastern Studies at Princeton University He is a Returned Peace Corps Volunteer from Morocco and holds an M.A. from the University of Michigan. He research in Morocco, Turkey, Gibraltar, and Dubrovnik has been funded by the Social Science Research Council and the Department of Education through the Fulbright-Hays Commission.
This Podcast was recorded on 10 January at the Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies (TALIM), in Tangier, Morocco. TALIM Resident Director John Davison moderated the discussion.
Posted by Hayet Lansari, Librarian, Outreach Coordinator, Content Curator (CEMA).

Thursday Feb 07, 2019
Anthropologie, généralisation et identité culturelle
Thursday Feb 07, 2019
Thursday Feb 07, 2019
Episode 57: Anthropologie, généralisation et identité culturelle
Dans ce Podcast, Pr. Hassan Rachik, Anthropologue à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Ain Chock Université Hassan II de Casablanca, interroge en profondeur le champ de l'anthropologie dans le contexte maghrébin en mettant l’accent sur les présupposés théoriques des travaux réalisés en la matière. Son argumentation s’articule autour des notions de dispositions théoriques, de dispositions culturelles et de rencontres anthropologiques.
En sciences sociales, et en anthropologie en particulier, les chercheurs utilisent des théories et des concepts pour caractériser des peuples (industrieux, pragmatique, laborieux, négociateur, etc.), leurs cultures (dionysiaque, apollinienne, modérée, excessive, etc.), leurs religions (fanatique, quiétiste, etc.). Ce type de caractérisation et de généralisation assez fréquent mérite d’être interrogé en explicitant et en critiquant ses présupposés théoriques, et dépassé en proposant un mode alternatif de généralisation qui ne met pas tout un peuple, tous les adeptes d’une religion, dans une même catégorie.
La conférence de Pr. Hassan Rachik a été programmée dans le cadre du cycle de conférences « Espaces et territoires au Maghreb » organisé par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA). Elle a eu lieu le 15 janvier 2019 au CEMA, Oran. Pr. Abdelkader Lakjaa, Sociologue à l'Université d'Oran 2 a modéré le débat.
Nous remercions Dr. Tamara Turner, Ethnomusicologue et chercheur au Max Planck Institute for Human Development, Centre for History of Emotions, pour son interprétation de Sidna Ali du répertoire du Diwan.
Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Thursday Jan 17, 2019
Les enjeux politiques du 11 décembre 1960
Thursday Jan 17, 2019
Thursday Jan 17, 2019
Episode 56: Les enjeux politiques du 11 décembre 1960
Dans ce Podcast, Dr. Amar Mohand Amer, historien et maître de recherche au Centre de Recherche en Anthropologie sociale et culturelle (CRASC), présente une conférence sur les enjeux politiques du 11 décembre 1960.
Ce moment historique n'est pas une simple manifestation historique, il est le marqueur d'un basculement majeur dans la Guerre de libération nationale. Il engage le FLN dans une nouvelle dynamique ou le peuple et la ville redeviennent des ferments de sa stratégie politiques et diplomatique.
Le 11 décembre 1960 est également la fin du mythe de la "Troisième force" et l'échec de la politique gaullienne sur le plan militaire, psychologique et économique.
La conférence de Dr. Amar Mohand Amer a été programmée dans le cadre du cycle des conférences « Histoire du Maghreb, histoire du Maghreb » organisé par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA). Elle a eu lieu le 12 décembre 2018 au CEMA, Oran. Dr. Saddek Benkada, Historien, Maître de recherche au CRASC et membre du Conseil Scientifique du CEMA a modéré le débat.
Nous remercions infiniment Mohammed Boukhoudmi d'avoir interprété un morceau musical de Elli Mektoub Mektoub, pour les besoins de ce podcast.
Montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday Dec 05, 2018
The Mad-For-Maghreb Generation : The Maghreb In the Pan-African Cultural Project
Wednesday Dec 05, 2018
Wednesday Dec 05, 2018
Episode 55: The Mad-For-Maghreb Generation :
The Maghreb In the Pan-African Cultural Project
Paraska Tolan Szkilnik is a PhD candidate at the University of Pennsylvania. She obtained her BA from Brandeis University in 2011 and an MA from the EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) in 2014, working on the relationship between Senegal and Tunisia in the 1960s and 70s. Her doctoral work is concerned with the history of cultural Pan-Africanism in the Maghreb in the decades following independence. Moving away from the strictly political approach of much of the literature on Pan-Africanism, her dissertation reconsiders the history of Pan-Africanism in the postcolonial period by centering on three Maghrebi cultural spaces of encounter between Black and non-Black African and Diaspora artists in the late 1960s and early 1970s: the Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), the Moroccan literary journal Souffles, and the Pan-African Festival of Algiers of 1969 (PANAF).
Beginning in Morocco, this podcast follows the adventures of a group of Luso-African poets and militants (chief amongst them Mario de Andrade, Marcelino dos Santos and Aquino Bragança) from Paris to Rabat. Starting in the late 1950s, these young militants used Rabat as a home-base for anti-colonial activism in the Portuguese colonies. The Moroccan government provided them with passports, headquarters, press coverage, and weapons. Morocco also served as a liberated space, on the African continent, to imagine what one could be in the wake of empire. In Rabat, these militant-poets met young Moroccan writers who were haunted by similar concerns over their role in the postcolonial world, amongst them poet Abdellatif Laabi founder of the Moroccan literary journal Souffles. Over the course of its seven years of publication, 1966-1973, Souffles took off from a marginal Moroccan literary journal to a paper caucus through which writers from across the African diaspora called for an African cultural revolution. On the pages of this shabby 30-something page journal, Laabi welcomed contributions from Haitian poet René Depestre, Moroccan novelist Tahar Ben Jelloun, Angolan insurgent Mario de Andrade, and Cape Verdean militant Amilcar Cabral. Working in tandem with these writers, the journal provided a platform to discuss the great issues of the decade: decolonization, Marxism-Leninism, civil rights in the United States, and of course Portuguese colonialism.
This episode is part of the Arts and Letters in the Maghrib series and was recorded on November 8th, 2018 at the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT), in Tunis, Tunisia.
The music in the introduction and conclusion of this podcast was performed by street artists on Avenue Bouguiba, Tunis, Tunisia.
Posted by Hayet Lansari, Librarian, Outreach Coordinator, Content Curator (CEMA).
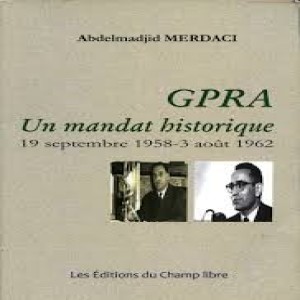
Wednesday Nov 07, 2018
GPRA, un mandat historique (1958-1962)
Wednesday Nov 07, 2018
Wednesday Nov 07, 2018
Episode 54: GPRA, un mandat historique (1958-1962)
Dans ce Podcast, Pr. Abdelmadjid Merdaci, sociologue et historien à l'Université de Constantine 2, présente son dernier ouvrage : GPRA, un mandat historique, 19 septembre 1958 - 3 août 1962 (Les Éditions du Champ Libre, 2018). Cet ouvrage s'attache à éclairer les conditions de formation du GPRA et en quoi la constitution du GPRA procédait-elle d'une solution de continuité dans la conduite de la guerre par le FLN-ALN et de quelle manière introduisait-elle une rupture historique significative ? Cela impose l'examen attentif des successives séquences ayant marqué la direction du FLN-ALN, de rapporter les choix des hommes et des objectifs à l'évolution du conflit tant au plan militaire que politique et diplomatique.
La conférence de Pr Abdelmadjid Merdaci a été programmée dans le cadre du cycle des conférences « Histoire du Maghreb, histoire du Maghreb » co-organisé par Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA) et le Centre de Recherche en Anthropologie sociale et culturelle (CRASC). Elle a eu lieu le 4 novembre 2018 au CEMA, Oran. Dr. Amar Mohand Amer, Maître de recherche au CRASC, a modéré le débat.
Nous remercions Dr. Jonathan Glasser, anthropologue culturel au College of William & Mary, pour son istikhbar in sika à l'alto pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.
Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday Oct 31, 2018
Wednesday Oct 31, 2018
Episode 53: The History of Pan-Africanism After Independence: The Pan-African Festival of Algiers of 1969 (PANAF)
Paraska Tolan Szkilnik is a PhD candidate at the University of Pennsylvania. She obtained her BA from Brandeis University in 2011 and an MA from the EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) in 2014, working on the relationship between Senegal and Tunisia in the 1960s and 70s. Her doctoral work is concerned with the history of cultural Pan-Africanism in the Maghreb in the decades following independence. Moving away from the strictly political approach of much of the literature on Pan-Africanism, her dissertation reconsiders the history of Pan-Africanism in the postcolonial period by centering on three Maghrebi cultural spaces of encounter between Black and non-Black African and Diaspora artists in the late 1960s and early 1970s: the Journées Cinématographiques de Carthage(JCC), the Moroccan literary journal Souffles, and the Pan-African Festival of Algiers of 1969 (PANAF).
In this podcast, Paraska Tolan Szkilnik gives us a sample of the fourth chapter in her dissertation, a chapter focusing on what she calls the Alt-PANAF, the group of radicals who participated in giving the festival its Pan-African character from the margins. These young actors, revolutionaries and writers did not meet on the rue Didouche Mourad or in the Palais des Nations. Instead they gathered in Algerian poet Jean Sénac’s stuffy basement apartment where they received Moroccan poets and editors of the revolutionary poetry journal Souffles, Haitian poet René Depestre, leader of the MPLA Mario Pinto de Andrade, and many more. Raised to the beat of Fanon’s The Wretched of the Earth,they were not enticed by the nationalistic promises of the ruling elite. Through personal interviews, critical reading of these writers’ fiction, and the material she have gathered in Jean Sénac’s archives in Algiers, she showcases the encounters that, though they did not occur in the spotlight, were just as crucial in building a community of radical artists committed to the project of African cultural unity. In this piece she tells the story of a handful of radicals from across the world who were looking to build a Pan-African network that ran deeper than the ceremonious speeches their presidents and state-sponsored artists so often delivered.
This episode is part of the Arts and Letters in the Maghrib series and was recorded on June 4th, 2018 at the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT), in Tunis, Tunisia.
The music in the introduction and conclusion of this podcast was performed by street artists on Avenue Bouguiba, Tunis, Tunisia.
Posted by Hayet Lansari, Librarian, Outreach Coordinator, Content Curator (CEMA).
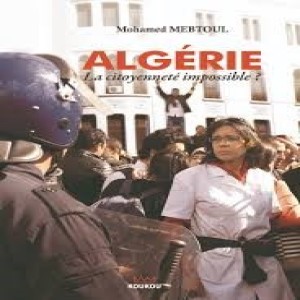
Wednesday Oct 10, 2018
Wednesday Oct 10, 2018
Episode 52: Rencontre avec Pr. Mohamed Mebtoul autour de son dernier ouvrage: Algérie, la citoyenneté impossible?
Dans ce Podcast, Pr. Mohamed Mebtoul, professeur de sociologie à l’université d’Oran 2, fondateur de l’anthropologie de la santé en Algérie et fondateur également du Groupe de Recherche en Anthropologie de la Santé (GRAS) devenue (Unité de recherche en sciences sociales et Santé), présente son dernier ouvrage : Algérie, la citoyenneté impossible ?
Partant d’une analyse empirique, dans le droit fil de l’anthropologie du quotidien, l’ouvrage du Pr. Mebtoul interroge en profondeur la question de la citoyenneté dans le contexte algérien. Il se donne pour objectif de répondre à cette problématique : Comment peut-on mettre l’épreuve la question de la citoyenneté par rapport aux comportements civiques ?
Pr. Mebtoul assigne à la citoyenneté à un double sens : le premier renvoie à une citoyenneté formelle régie par le droit, le second à une citoyenneté informelle consistant à avoir un sentiment d’appartenance à une communauté sociale. Pr. Mebtoul revient avec beaucoup de détails sur les multiples enjeux qui sous-tendent le champ social en Algérie : le clientélisme, le patriarcat politique et social, la corruption, la cooptation, l’allégeance et l’informel.
La conférence de Pr Mohamed Mebtoul a été programmée dans le cadre du cycle des conférences « Soirées ramadanesques» co-organisé par Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA) et l'Institut de Développement des Ressources Humaines (IDRH). Elle a eu lieu le 29 mai 2018 à l'IDRH, Oran. Dr Belkacem Benzenine, Maître de recherche au CRASC, a modéré le débat.
Nous remercions notre ami Ignacio Villalón pour sa prestation à la guitare pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.
Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday Oct 03, 2018
Why William Wordsworth is needed today
Wednesday Oct 03, 2018
Wednesday Oct 03, 2018
Episode 51: Why William Wordsworth is needed today
Dr. Mounir Khélifa studied English at the Sorbonne and Yale University where he received his MA and PhD, respectively. A professor of English language and literature for more than three decades, he taught poetics, comparative literature, and literary theory at the University of Tunis. Former director of the graduate program in English, Dr. Khélifa was also a senior advisor to the Ministry of Higher Education and Scientific Research, where has was responsible for international cooperation and curriculum reform. Currently Dr. Khélifa runs the School for International Training study-abroad program in Tunisia. He is a lifetime member of the Tunisian Academy for the Arts, Letters, and Sciences.
This episode is part of the Contemporary Thought series and was recorded on May 7th, 2018 at the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT).
We thank the duo Ÿuma for use of their song, "Hleli," from their album Ghbar Njoum for the introduction and conclusion of this podcast.
Posted by Hayet Lansari, Librarian, Outreach Coordinator, Content Curator (CEMA).

Wednesday Sep 19, 2018
Rencontre avec Bouziane Ben Achour autour du théâtre algérien d'aujourd'hui
Wednesday Sep 19, 2018
Wednesday Sep 19, 2018
Episode 50: Rencontre avec Bouziane Ben Achour autour du théâtre algérien d'aujourd'hui
Dans ce Podcast, M. Bouziane Ben Achour, écrivain, dramaturge et journaliste, retrace la trajectoire du théâtre algérien en mettant l’accent sur ses expressions actuelles. M. Ben Achour défend l’idée que le théâtre est le reflet de la société et de ses multiples dynamiques. Depuis la création des compagnies théâtrales ou ce que l’on appelle les coopératives théâtrales, le théâtre algérien n’a pas cessé d’évoluer et d’accompagner les dynamiques sociales en s’y adaptant parfois, même s’il est grandement concurrencé suite à l’ouverture du champ audiovisuel en Algérie qui a développé une culture d’appartement. M. Ben Achour a souligné que le théâtre algérien a toujours été politique du temps du mouvement national à nos jours, et c’est pratiquement l’un des rares secteurs culturels à avoir échappé à la censure. M. Ben Achour a également interrogé dans son exposé les rouages de la machine théâtrale en Algérie en passant en revue ses modalités de financement et de sponsoring. Au fil de son exposé, M. Ben Achour a soulevé la question du public théâtral qui a lui aussi subi des métamorphoses conduisant à de nouvelles pratiques théâtrales. M. Ben Achour a conclu son exposé sur une note d’espoir en disant qu’il y a une vraie culture d’initiative parmi les jeunes et qu’un renouveau est en train de se produire grâce à des activités menées par des jeunes qui ne s’insèrent pas dans les modèles structurels traditionnels, donnant ainsi un nouveau souffle à la création théâtrale en Algérie.
Bouziane Ben Achour est journaliste, romancier, dramaturge et essayiste. Parmi ses romans, l’on peut citer : Sabrinel (Éditions Enadar, 2018); Kamar ou le temps abrégé (Éditions ANEP, 2016); et Brûlures (2012) qui a eu le Prix littéraire Mohamed Dib. Il est également l’auteur de trois essais sur la musique et le théâtre algérien.
Dramaturge, Bouziane Ben Achour a écrit quinze pièces théâtrales toutes montées par les théâtres régionaux et les compagnies privées. Sa pièce Yamna (2015) produite par le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi- Ouzou, a été mise en scène par la grande dame de la scène algérienne, Sonia. Hbil Soltane (2018) est sa dernière œuvre théâtrale produite par l’association El –Murdjadjo d’Oran.
La conférence de M. Bouziane Ben Achour est programmée dans le cadre du cycle des conférences « soirées ramadanesques » co-organisé par Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA) et l'institut de Développement des Ressources Humaines (IDRH). Elle a eu lieu le 24 Mai 2018 à l'IDRH, Oran. Pr Hadj Miliani, Professeur de littérature à l'université de Mostaganem, chercheur associé au CRASC, a modéré le débat.
Nous remercions notre ami Ignacio Villalón pour sa prestation à la guitare pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.
Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday Sep 12, 2018
Muhammad I al-Mustansir of Tunis and the Northern Mediterranean
Wednesday Sep 12, 2018
Wednesday Sep 12, 2018
Episode 49: Muhammad I al-Mustansir of Tunis and the Northern Mediterranean
In this episode, Dr. Michael Lower, Associate Professor of History at the University of Minnesota, discusses the world of Muhammad I al-Mustansir of Tunis and his relationship with the northern Mediterranean
His recent research on the crusades tries to bring together Arabic and European-language sources to tell the story of these complex multi-lateral conflicts from multiple perspectives. He is the author of "The Barons' Crusade of 1239: A Call to Arms and Its Consequences" (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005) and "The Tunis Crusade of 1270: A Mediterranean History" (Oxford: Oxford University Press, 2018).
This was recorded on 14 February 2018 at at the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT) Early Hafsid Tunis: Capital of Caliphate Symposium.
posted by Hayet Lansari, Librarian, outreach coordinator, content curator (CEMA)

Wednesday Sep 05, 2018
La résilience architecturale en Mauritanie
Wednesday Sep 05, 2018
Wednesday Sep 05, 2018
Episode 48: La résiliance architecturale en Mauritanie
Dans cet épisode, Dr. Franklin Graham, professeur de géographie à l'University of South Florida, présente une communication sur la résilience architecturale en Mauritanie.
Traditionnellement le peuple sédentarisé en Mauritanie construisait leurs édifices et murs à base de pierres et d`argile. Le mot « toqleedi » en Arabe et en Hassaniyya, explique cette maçonnerie traditionnelle. Typiquement, les pierres sont d’origine sédimentaire et elles proviennent d'anciennes couches océaniques. Le grès, facile de retirer est mélangé à l’argile locale; la majorité des bâtiments ont été construits de cette façon. Des anciens quartiers d’Atâr, Ouâdâne, Chinguetti, Tidjikja, Er-Rachid, Ksar el-Barka et Oualata en sont des modèles. Dans les sites spécifiques, comme à Terjitt, Aoujeft, Tichitt et Néma, la schiste et l’argile sont utilisés par le peuple de « Trab el Hajra » pour bien profiter de leurs ressources locales. Pour charpenter les toits, ils utilisaient les plantes cultivées dans les jardins ou les plantes sauvages trouvées près de leurs habitations. Le bois de palmier, du dattier, « en nakhîl » en Arabe, trouvé dans les palmeraies, généralement fut utilisé à supporter les toits. Les arbres d’acacia, « talha et tamât », et le bois de dattier sauvage « teïchott » en Hassaniyya, étaient ramassés et utilisés pour renforcer les seuils et pour fabriquer les portes et les fenêtres. Typiquement les personnes s'adaptaient à l’environnement pour construire leurs maisons, magasins, greniers et mosquées.
Les traditions peuvent évoluer dans le temps. Effectivement la maçonnerie mauritanienne témoigne d’un changement dynamique et profond. Mais le changement n’est ni facile ni uniforme à comprendre. Pour des raisons diverses des villes et villages toqleedi sont en train de vivre une renaissance, ils sont tombés dans l'oubli. Les circonstances environnementales, économiques et sociales influencent cette complexité. Ci-dessous se trouve le bilan des entretiens et observations enregistrées dans les onze villes et villages dans l’intérieur de la Mauritanie durant l’été 2017. Quarante-trois maçons ont été interviewés à Ouâdâne, Chinguetti, Aoujeft, Tidjikja, Er-Rachid, Tichitt et Oualata. L’enquête a démontré que le type de maçonnerie concernant les quartiers d’Ouâdâne, Chinguetti, Atâr, Tidjikja, Tichitt, Oualata, Néma et Ksar el Barka a été abandonné avant la période coloniale. Le site de Terjitt est le plus petit et dispose d'un ancien quartier, et le reste est habité et sillonné par une ancienne ville qui s’appelle en Hassaniyya et en Arabe « El Qadeema ».
Ci-dessous, les résultats de la recherche sont expliqués pour chaque site, un sommaire est consacré aux régions de l’Adrâr, du Tagant et de l’Hodh ech-Chargui, et en conclusion pour la Mauritanie. Des propositions pour une recherche éventuelle sont proposées dans la conclusion.
La conférence de Dr. Franklin Graham a eu lieu le 26 juin 2018 au Tangier American Legation Institute of Moroccan Studies (TALIM),à Tanger, Maroc.
Pour consulter les diaporamas et la bibliographie, visitez notre site web: www.themaghribpodcast.com
Posté par Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday Aug 29, 2018
Le patrimoine en question : Entre métissages et territoires linguistiques
Wednesday Aug 29, 2018
Wednesday Aug 29, 2018
Episode 47: Le patrimoine en question : Entre métissages et territoires linguistiques
Dans ce Podcast,Pr. Nadir Marouf interroge en profondeur la question du patrimoine / patrimonialité / patrimonialisation / néo-patrimonialisme dans ses différentes ramifications historiques, socio-culturelles, stratégiques et autres. Il l’aborde essentiellement du point de vue des métissages / territoires linguistiques et des processus de socialisation. Il interroge également les articulations entre la question de l’espace et de la temporalité dans le contexte maghrébin. Les pratiques syncrétiques au Maghreb et ailleurs sont également au cœur de son intervention, la praxis populaire donne à voir des pratiques opposées au rites canoniques dominants. Au fil de son exposé, Pr. Marouf revient, exemples à l’appui, sur les différents rapports à l’historicité représentés dans la conscience populaire maghrébine.
Pr. Nadir Marouf est né en 1940 à Tlemcen, titulaire d’un doctorat en droit public interne (Université Paris I) et d’un doctorat ès Lettres (Université Paris V). Il a enseigné la sociologie et l’anthropologie appliquée à l’université d’Oran entre 1968 et 1988, l’Université d’Aix-Marseille entre 1981 et 1982, l’Université de Harvard en 1989, l’Université de Lille I entre 1988 et 1991, et l’Université de Picardie Jules Verne entre 1991 et 2009. Il est actuellement Professeur Émérite. Il a été directeur du CRASC (anciennement URASC) de 1984 à 1989, et directeur du CEFRESS (1994-2007). Il a notamment travaillé sur la sociologie et anthropologie maghrébine.
Parmi ses centres d’intérêt, l’on peut citer sans être exhaustif : l’espace oasien, l’espace maghrébin, les fondements anthropologiques de la norme maghrébine, le chant arabo-andalou, les cultures et métissages, le fait colonial au Maghreb…etc. Ces différentes thématiques sont au centre de sa réflexion et production scientifiques.
La conférence de Pr. Nadir Marouf est programmée dans le cadre du cycle de conférences « Langues et sociétés au Maghreb ». Elle a eu lieu le 06 Mars 2018 à Oran, au Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA). Pr Abdelkrim El Aidi, sociologue à l'université d'Oran 2 a modéré le débat.
Nous remercions notre ami Mohammed Boukhoudmi pour son interpretation de l'extrait de nouba, "Dziriya," par Dr. Noureddine Saoudi pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.
Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).
